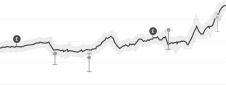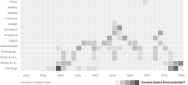Jean TASSEL Langres, 1608 - 1667
La diseuse de bonne aventure
Huile sur toile
(Restaurations)
The Fortune Teller, oil on canvas, by J. Tassel
h: 69 w: 91,50 cm
Provenance : Galerie Hahn, Paris ;
Acquis auprès de celle-ci par l"actuelle propriétaire ;
Collection particulière, Paris
Bibliographie : "L"œil", n° 398, septembre 1988, p. 62-63, fig. 17
Henri Ronot, "Richard et Jean Tassel, peintres à Langres au XVIIe siècle", Paris, 1990, p. 312, n° 119, repr. pl. XXXIX (légende inversée avec pl. XXXVIII)
Commentaire : Thème privilégié des suiveurs du Caravage, "La Diseuse de bonne aventure" connut un succès incontestable dans la peinture romaine et française au début du XVIIe siècle. Cette allégorie de la tromperie et de la naïveté met en scène un jeune homme dupé par une bohémienne. Formé dans l"atelier de son père à Langres, Jean Tassel séjourna à Rome en 1634 où il copia la "Transfiguration" de Raphaël, observa les Bolonais et retint les leçons du Caravage. Outre le sujet, Tassel reprend dans ce tableau les spécificités des compositions caravagesques : un cadrage resserré qui permet au spectateur d"être immergé dans l"œuvre, des figures à mi-corps, une scène saisie sur le vif, un fond neutre qui focalise l"attention sur les personnages et un traitement de la lumière en clair-obscur. Le jeu de mains du jeune homme trompé et de la diseuse de bonne aventure et l"alternance de lumière blanche et chaude sur les visages sont à rapprocher d"un tableau de même sujet peint en 1620 par Simon Vouet (musée d"Ottawa). Henri Ronot, auteur de la monographie de Tassel, tient toutefois à souligner que le jeune homme est vêtu d"un costume français qui lui permet d"envisager une datation de l"œuvre dans les années 1645-1650. C"est donc un exemple plutôt tardif du traitement de ce thème déjà peint par Manfredi, et les français Valentin, Vouet et Georges de La Tour.
Une version de plus grand format de la "Diseuse de bonne aventure" a été acquise en 2014 par le musée Fabre de Montpellier. Notre tableau reprend cette composition avec des variations qui ne laissent pas de doute sur le travail de la main du maître. L"artiste a vêtu la bohémienne d"une coiffe nouvelle, de couleur blanche. Dans le premier tableau, les cheveux noirs de la jeune femme se confondaient avec le fond de la toile, or ce couvre-chef - présent chez Caravage et Valentin - permet de rythmer la composition et contribue à une meilleure lisibilité de l"œuvre. Au sein du corpus de Jean Tassel composé principalement de tableaux religieux et mythologiques, cette toile se distingue par l"originalité de son sujet et du traitement de ses figures si spécifiques au peintre langrois.
Œuvres en rapport :
- Une toile de même sujet et de dimensions plus grandes (Montpellier, musée Fabre, inv. 2014.9.1)
- Une version d"atelier, 93,5 x 123,5 cm (vente Aguttes, 17 juin 2008, n° 37).
Estimation 50 000 - 80 000 €